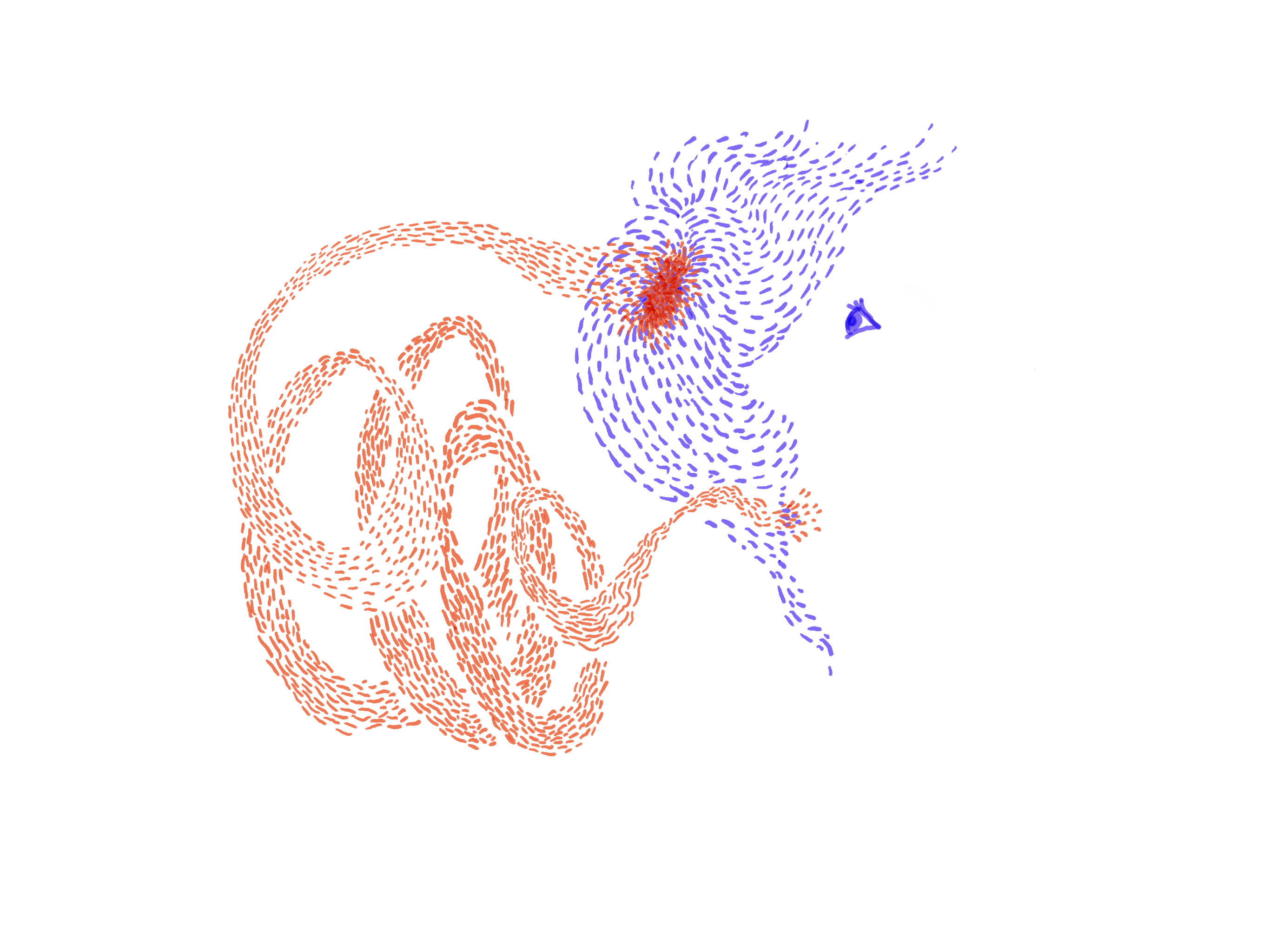Un alambic au conservatoire.
Pour ce dernier temps d'enquête, nous allons voir ce qu'il se passe au conservatoire - ateliers des arts. On y croise une céramiste de retour du Mexique, un sculpteur fondeur amateur de parfum et un tubiste joueur de serpent d'église.
L'odeur de l'argile verte
Marie Lac est céramiste, elle remplace Pierre Pauzon - qu'on espère aussi voir revenir bientôt - à l’atelier des arts où elle enseigne le modelage et la céramique. Traductrice au mexique, elle y a commencé la poterie pour ne plus jamais s’arrêter. Nous parlons ensemble des odeurs de la terre. Bien qu’elle m’explique que l’odorat soit le sens qu’elle utilise le moins, la potière décrit des odeurs de cuisson à éviter parcequ’elles renvoient des gaz, de terres croupies ou moisies, mais aussi celles de la terre qu’on modèle au creux de la main, ou encore celle de la terre sèche qui ne sentirai plus rien.
Ce dont elle me parle je crois, c’est une expression du fluide dans la terre, une histoire d’eau finalement.
L’eau qui stagne, retenue dans l’argile , la vie qui s’y installe et qui de fait pue. Et puis cette vie qui disparaît ou bien plutôt se rabougrit avec le séchage, le désert.Dans le four tout brûle, on en chasse les dernières molécules. A quelques 1200 degrés, c’est la reconfiguration de la matière, tout se reformule comme aux premiers ages... de la terre.
A la fin de notre rencontre, nous évoquons les différentes argiles ceramique - ont-elles des odeurs différentes ? Y a-t-il des singularités dans les différentes argiles disponibles dans le territoires. Peut-être; mais très peu de céramistes utilisent encore des argiles qu’ils extraient eux-mêmes pour faire des pots. L’industrialisation d’extraction et de rafinage des terres à modeler à soulagé le potier d’un travail pénible, mais elle l’a probablement éloigné aussi des sensations d’une géologie spécifique ancrée dans un territoire. Marie par exemple utilise un grès de Bourgogne. Par ailleurs, d’après l’expérience de Pierre qu’elle remplace aux ateliers des Arts les argiles vertes que l’on voit affleurer aux alentour du puy, de Blanzac ou de Blavozy font de médiocre poterie d’autant qu’elles perdent cette jolie couleur à la cuisson pour un orange un peu décevant.
Trouver la bonne distance
A l'atelier des Arts également, je rencontre enfin Sébastien, avec qui nous abordons un atelier autour des encres naturelles. Il évoque avec moi les odeurs de son atelier, celle des cires minérales qu'il utilise en fonderie, les limailles métalliques issues des étapes de finition. Mais à un moment de l'entretien, il se passe un truc. Il m'explique qu'il est devenu plus sensible aux odeurs corporelles. Dans une situation d'enseignement, il y a aussi des situations de proximités qu'il considère comme un peu envahissante. Il présente le parfum comme un outil pour conserver une distance appropriée avec ses élèves.
Le nez à-t-il des Oreilles ?
Il se trouve qu’au commencement de ce projet, il y a un professeur de tuba et de serpent qui invite un musicien improvisateur dont une des pratiques est de jouer sous l’influence de parfums. C’est un peu à cause de Loïc qu’un conservatoire de musique finit par passer commande d’une cartographie olfactive des terres du Velay à une artiste et un designer.
En italien, entendre se dit "sentire", une des raisons de l’emploi de cette langue pour nommer ce projet Fare l’aria, litérallement faire l’air. La respiration par le nez ou par la bouche, c’est la base !
Mais ce qu’il me raconte, c’est une histoire de tuyaux, de bave et de réactions chimiques. "Les cuivres, c'est un peu comme des alambics." Les métaux de l'instrument s'oxydent au contact de l'haleine des musiciens. C'est pour cela qu'il faut constamment nettoyer son instrument - mais pour le tuba, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, on ne s'en rend pas compte quand on y est, mais il suffit de sortir et de revenir dans une classe d'orchestre de cuivre pour sentir une odeur qui disons,... donne envie d'ouvrir la fenêtre.
Il me dit aussi que l’huile des pistons, sent l’huile minérale, une correspondance entre la mécanique des moteurs et celles des instruments de musiques inventés avec la révolution industrielle. Peut-être finalement que l’odeur de l’atelier poids lourd de Josyane et Kevin ressemble à celle qui sort du cornet du Tuba de Loïc.
Pour lui, l’odorat renvoie à quelque chose de primitif, qu'il ne rattache pas à une "culture". Il y a bien sûr une culture olfactive qui existe, mais le fait qu’on la fréquente peu dans notre éducation donne aussi l’occasion d’accéder selon lui à un sens plus animal, plus pûr ou peut-être naïf. Loîc note que beaucoup de musiciens cuivre, sentent l'embouchure de leur instrument avant un concert. Un geste d'attachement instinctif qu'il associe à une sorte de doudou.
Je lui demande si le nez à des oreilles ou du moins si les oreilles ont du nez. Peut-on sentir par l’écoute ? Bien que la question le laisse un peu sans voix au départ, il accepte de jouer le jeu. Pour lui, on peut dire que l’on peut associer ce que l’on sent à ce que l’on entend : par le souvenir d’un son on peut convoquer son odeur.le bruit du vent dans les arbres pour convoquer une odeur de sapin, celui de la mer pour convoquer les embruns ou encore le frisson des oeufs dans la poêle. L’expérience du concert olfactif l’a ammené à réfléchir à son enseignement. Notamment comment transmettre des émotions - dans l’enseignement musical. S’attacher un peu moins à raconter quelque chose au travers de la musique qu’à le faire sentir ou du moins ressentir.
S'eduquer par les odeurs
En suivant une odeur on déplie un lien vivant, en passant d’une matière à un être qui la transforme. Les connaissances, les croyances mais aussi ce qu’on peut imaginer, spéculer sur les actes des animaux, des humains, des réactions chimiques,... engagent celles et ceux qui souhaitent s’y intéresser dans une conversation dont émerge une forme de savoir bien particulière.
Aborder l’éducation depuis l’odorat c’est donc aussi fabriquer des connaissances qui permettent de se lier autrement avec le vivant.
Comme nous y invite l’historienne de l’art Clara Müller, il s’agirait d’explorer un sens autochtone des odeurs. Quel sens à l’odeur pour ce qui l’émet ? Que signifie le parfum d’une fleur pour une fleur elle-même … et quel sens a-t-il pour l’humain qui le transforme ? C’est cette chaîne de transformation, témoin d’un flux du vivant qu’il paraît important de reconstruire dans nos imaginaires.
 FarelAria
FarelAria